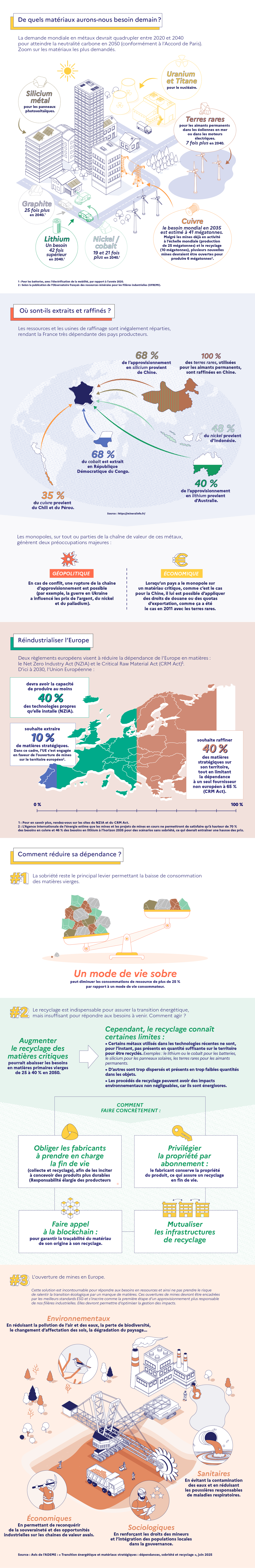Batteries, éoliennes, panneaux solaires… toutes ces technologies dépendent de métaux dits critiques : ils sont essentiels pour la transition énergétique, mais leur extraction et leur raffinage sont inégalement répartis à l’échelle mondiale. Face à cette dépendance, l’Europe cherche à sécuriser ses approvisionnements et à renforcer le recyclage. L’ADEME a publié un Avis avec l’appui de l’Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (OFREMI).
De quels matériaux aurons-nous besoin demain ?
La demande mondiale en métaux devrait quadrupler entre 2020 et 2040 pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (conformément à l’Accord de Paris).
Zoom sur les matériaux les plus demandés.
- Silicium métal :pour les panneaux photovoltaïques.
- Uranium et Titane : pour le nucléaire.
- Terres rares : pour les aimants permanents dans les éoliennes en mer ou dans les moteurs électriques (7 fois plus en 2040).
- Pour les batteries, avec l’électrification de la mobilité, par rapport à l’année 2020 :
- Lithium : un besoin 42 fois supérieur en 2040¹.
- Graphite : 25 fois plus en 2040.
- Nickel / cobalt : 19 et 21 fois plus en 2040.
- Cuivre : le besoin mondial en 2035 est estimé à 41 mégatonnes. Malgré les mines déjà en activité à l’échelle mondiale (production de 25 mégatonnes) et le recyclage (10 mégatonnes), plusieurs nouvelles mines devraient être ouvertes pour produire 6 mégatonnes. (Selon la publication l’Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles (OFREMI)).
Où sont-ils extraits et raffinés ?
Les ressources et les usines de raffinage sont inégalement réparties, rendant la France très dépendante des pays producteurs.
- 100 % des terres rares, utilisées pour les aimants permanents, sont raffinées en Chine.
- 68 % de l’approvisionnement en silicium provient de Chine.
- 68 % du cobalt est extrait en République Démocratique du Congo.
- 48 % du nickel provient d’Indonésie.
- 40 % de l’approvisionnement en lithium provient d’Australie.
- 35 % du cuivre provient du Chili et du Pérou.
Source : https://mineralinfo.fr/
Les monopoles, sur tout ou parties de la chaîne de valeur de ces métaux, génèrent deux préoccupations majeures :
- GÉOPOLITIQUE
En cas de conflit, une rupture de la chaîne d’approvisionnement est possible (par exemple, la guerre en Ukraine a influencé les prix de l’argent, du nickel et du palladium). - ÉCONOMIQUE
Lorsqu’un pays a le monopole sur un matériau critique, comme c’est le cas pour la Chine, il lui est possible d’appliquer des droits de douane ou des quotas d’exportation, comme ça a été le cas en 2011 avec les terres rares.
Réindustrialiser l’Europe
Deux règlements européens visent à réduire la dépendance de l’Europe en matières : le Net Zero Industry Act (NZIA) et le Critical Raw Material Act (CRM Act). D’ici à 2030, l’Union Européenne :
- devra avoir la capacité de produire au moins 40 % des technologies propres qu’elle installe (NZIA).
- souhaite extraire 10 % de matières stratégiques. Dans ce cadre, l’UE s’est engagée en faveur de l’ouverture de mines sur le territoire européen. L’Agence internationale de l’énergie estime que les mines et les projets de mines en cours ne permettront de satisfaire qu’à hauteur de 70 % des besoins en cuivre et 46 % des besoins en lithium à l’horizon 2035 pour des scénarios sans sobriété, ce qui devrait entraîner une hausse des prix.
- souhaite raffiner 40 % des matières stratégiques sur son territoire, tout en limitant la dépendance à un seul fournisseur non européen à 65 % (CRM Act).
Comment réduire sa dépendance ?
#1. La sobriété reste le principal levier permettant la baisse de consommation des matières vierges.
Un mode de vie sobre peut diminuer les consommations de ressource de plus de 25 % par rapport à un mode de vie consommateur.
#2. Le recyclage est indispensable pour assurer la transition énergétique, mais insuffisant pour répondre aux besoins à venir. Comment agir ?
Augmenter le recyclage des matières critiques pourrait abaisser les besoins en matières primaires vierges de 25 à 40 % en 2050.
Cependant, le recyclage connaît certaines limites :
- Certains métaux utilisés dans les technologies récentes ne sont, pour l’instant, pas présents en quantité suffisante sur le territoire pour être recyclés. Exemples : le lithium ou le cobalt pour les batteries, le silicium pour les panneaux solaires, les terres rares pour les aimants permanents.
- D’autres sont trop dispersés et présents en trop faibles quantités dans les objets.
- Les procédés de recyclage peuvent avoir des impacts environnementaux non négligeables, car ils sont énergivores.
Comment faire concrètement ?
- Obliger les fabricants à prendre en charge la fin de vie (collecte et recyclage), afin de les inciter à concevoir des produits plus durables (Responsabilité élargie des producteurs (REP)).
- Privilégier la propriété par abonnement : le fabricant conserve la propriété du produit, ce qui assure un recyclage en fin de vie.
- Faire appel à la blockchain : pour garantir la traçabilité du matériau de son origine à son recyclage.
- Mutualiser les infrastructures de recyclage.
#3. L’ouverture de mines en Europe.
Cette solution est incontournable pour répondre aux besoins en ressources et ainsi ne pas prendre le risque de ralentir la transition écologique par un manque de matières. Ces ouvertures de mines devront être encadrées par les meilleurs standards ESG et s’inscrire comme la première étape d’un approvisionnement plus responsable de nos filières industrielles. Elles devront permettre d’optimiser la gestion des impacts.
- Environnementaux
En réduisant la pollution de l’air et des eaux, la perte de biodiversité, le changement d’affectation des sols, la dégradation du paysage… - Sanitaires
En évitant la contamination des eaux et en réduisant les poussières responsables de maladies respiratoires.
- Sociologiques
En renforçant les droits des mineurs et l’intégration des populations locales dans la gouvernance. - Économiques
En permettant de reconquérir de la souveraineté et des opportunités industrielles sur les chaines de valeur avals.