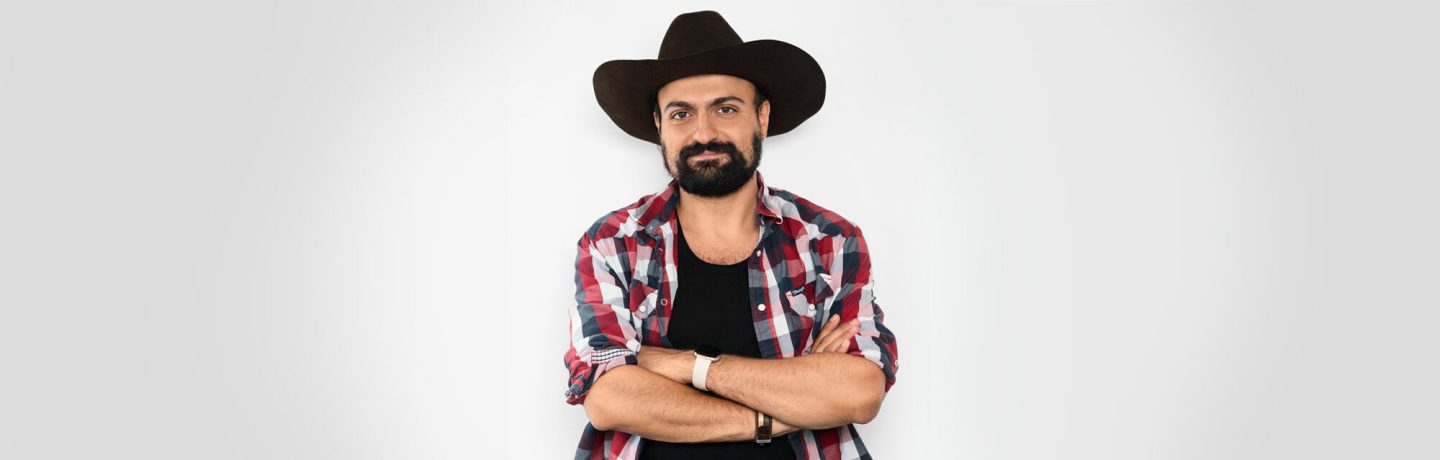Passionné de météo et chasseur d’orages, Serge Zaka est docteur en agroclimatologie et chercheur modélisateur scientifique. Sur X (ex-Twitter), il débunke les climatosceptiques et fait de la vulgarisation à grande échelle. Il nous explique pourquoi il va falloir refonder toute notre agriculture d’ici 2050.
C’est l’étude de l’impact du changement climatique sur l’agriculture. L’agroclimatologie sert à prendre des décisions de long terme. Par exemple, si je suis agriculteur, pourrai-je faire pousser des pommes de terre dans le Nord-Pas-de-Calais en 2050 ou planter des oliviers dans le centre de la France ? On distingue cette discipline de l’agrométéorologie qui est l’étude de l’impact de la météo sur l’agriculture et qui sert à prendre des décisions rapides. Dois-je irriguer mon champ demain ? Faut-il sortir les fils anti-grêle pour ma vigne ? En réalité, tous les agriculteurs sont agro-météorologues. Les deux disciplines sont complémentaires et indispensables pour la sécurité alimentaire du pays.
La journée-type dépend de la journée ! Lorsqu’un événement météorologique extrême survient, comme une canicule ou une vague de froid, j’enfile mon costume d’agrométéorologue. Je surveille l’événement et je conseille les agriculteurs sur la marche à suivre pour protéger leurs cultures. Sur une journée « normale », je donne des conférences et je propose des formations aux agriculteurs, notamment sur les adaptations nécessaires, terre par terre, pour leur activité agricole.
Depuis 50 ans, le nombre de canicules a été multiplié par 4 en France. C’est 4 fois plus de stress thermique sur les végétaux. L’augmentation du nombre de sécheresses affecte en premier lieu les cultures d’été, comme les pommes de terre, la betterave, le tournesol, les pommes et les poires, avec des pertes de rendement liées au manque d’eau. À l’inverse, les cultures d’hiver sont plutôt « favorisées » – pour l’instant – par la hausse des températures car elles ont encore de l’eau disponible dans les sols. Ainsi, l’orge d’hiver, le colza d’hiver ou encore le blé d’hiver poussent plus vite actuellement. Mais les variations extrêmes de température qui se multiplient altèrent la capacité des espèces naturelles à « résister au stress thermique ». Le 28 juin 2019, lorsqu’il a fait 46° dans l’Hérault, plusieurs dizaines de milliers d’hectares de vignes sont parties en fumée. 12 % de la production a été perdue en 4h, on parlait même d’un « chalumeau géant qui avait tout brûlé ».
Beaucoup d’arbres ont besoin du froid pour démarrer leur floraison. La douceur hivernale entraîne donc des pertes de rendement sur l’arboriculture. Depuis 50 ans, la douceur hivernale a avancé la floraison des cerisiers de 10 jours. Les vendanges ont elles aussi avancé de 18 jours. Problème : nous avons toujours des épisodes de gel. Il y a donc un risque que les bourgeons soient ouverts et que la floraison soit stoppée net.
C’est l’aire de répartition des cultures en fonction du climat. Chaque culture au XXe siècle a été répartie pour être adaptée à son climat. Aujourd’hui, cette biogéographie évolue et les cultures doivent migrer vers le nord, car elles ne sont plus dans leur zone de biogéographie favorable. Il faut accepter qu’on ne cultivera pas la même chose au même endroit. Les agriculteurs ont déjà commencé à le faire, comme certains vignerons dans l’Aude qui se sont mis à planter de l’aloe vera sur leurs parcelles caillouteuses. La production de tomates se fera dans le centre de la France, les pommes de terre vers l’Europe de l’Est… Cultiver là où est le climat favorable, comme on l’a toujours fait. Les agriculteurs vont devoir diversifier leurs productions, c’est indispensable pour ne pas être vulnérables aux épisodes climatiques importants.
Parce qu’il ne suffit pas de changer l’emplacement des cultures, nous devons aussi faire évoluer notre façon de cultiver. Le sol ne doit plus être considéré comme un simple support mais comme une source de fertilité. Il faut l’enrichir, limiter au maximum tout travail mécanique, couvrir la terre par des cultures intermédiaires comme les légumineuses… Nous allons devoir faire de l’hydrologie régénérative , une « gestion durable de l’eau » qui vise à favoriser la santé des sols, l’infiltration de l’eau, la régulation du cycle de l’eau et la résilience face aux événements climatiques extrêmes. Tout le monde est concerné. Les citoyens en achetant local et de saison, mais aussi les politiques et industriels agro-alimentaires qui doivent aussi soutenir les agriculteurs dont le revenu est aujourd’hui basé sur le rendement. Demain, il devra aussi prendre en compte le service écosystémique (la plantation de haies, le stockage de carbone, l’adaptation des pratiques…). Il faut intégrer dans la politique agricole commune des financements spécifiques pour les agriculteurs qui s’efforcent d’intégrer davantage l’environnement dans leur activité.
Les cultures au sud de la France vont monter vers le nord. Les paysages vont changer, on verra de la garrigue jusqu’à Lyon et Bordeaux. On pourra cultiver du tournesol et du maïs dans les Hauts-de-France. Les vaches laitières monteront en altitude et on privilégiera l’élevage d’ovins, qui sont moins consommateurs de fourrage. Les grandes étendues et les monocultures vont disparaître.
Mon conseil : ne regardez pas en arrière, oubliez les anciennes cultures. Le challenge aujourd’hui, c’est de créer notre alimentation du futur. Le changement climatique ne doit pas être vu comme une perte de potentiel agricole. C’est l’opportunité de trouver de nouvelles cultures et ce n’est pas la fin de l’agriculture en France !